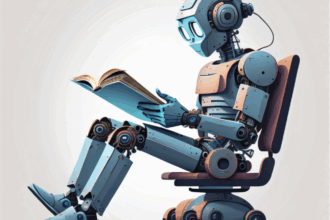Depuis mars 2022, la France s’est dotée de son premier pôle judiciaire dédié aux cold cases, ces affaires criminelles non élucidées qui hantent les tribunaux et les familles depuis des décennies. Installé au tribunal de Nanterre, ce service unique a pour mission de relancer des enquêtes en suspens, en exploitant les avancées scientifiques et technologiques récentes.
Par LENA HOUSSET
(Un article publié dans Perspectives #4)
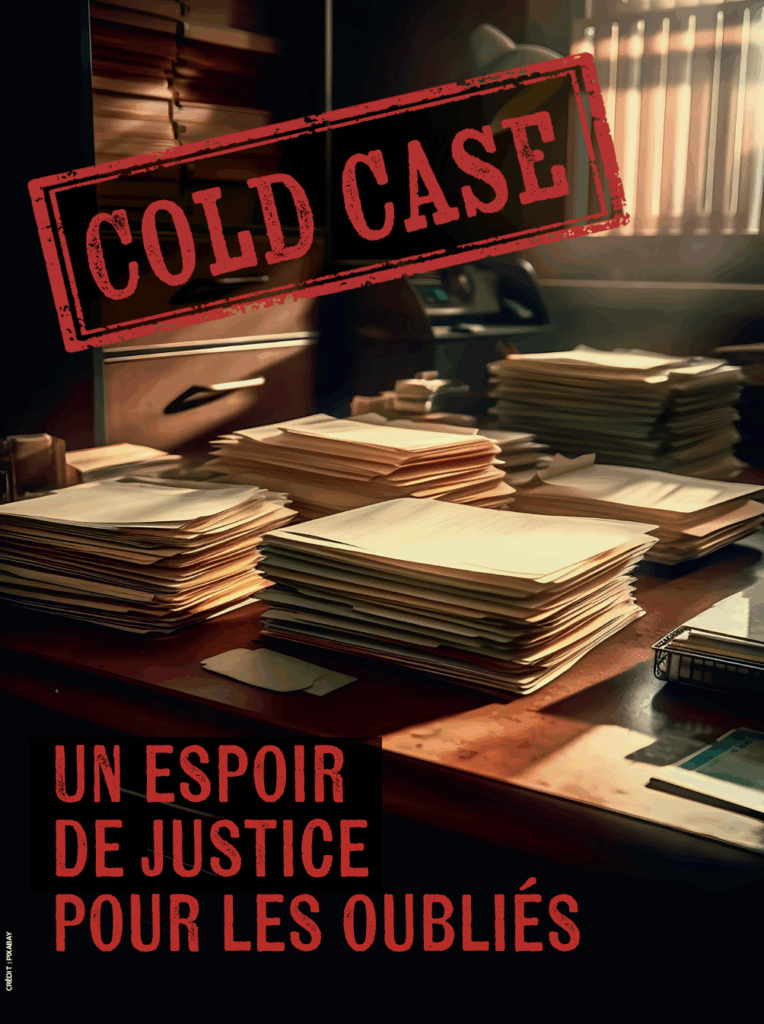
La création du pôle cold case de Nanterre en 2022 marque un tournant majeur dans la justice française; elle répond à une lacune longtemps dénoncée par les familles de victimes et les professionnels du droit. Jusqu’alors, les affaires non élucidées étaient traitées de manière éparse par des juges d’instruction déjà surchargés, rendant leur résolution difficile. « À l’époque, lorsqu’un enfant disparaissait, si aucune avancée n’était réalisée au bout de deux ans, le juge d’instruction pouvait clore le dossier, même si l’enquête n’était pas aboutie. Je ne dirais pas que ces affaires étaient bâclées car c’était la procédure mais il est évident que de nombreuses enquêtes ont été mises de côté sans que la justice se donne réellement les moyens de les résoudre », déclare Alain Boulay, président et fondateur de l’association Aide aux Parents d’Enfants Victimes. En centralisant ces dossiers au sein d’une structure spécialisée, la justice française se dote enfi n d’un outil permettant d’examiner ces enquêtes avec une approche plus approfondie et méthodique. « Depuis la création du pôle cold case de Nanterre, il y a énormément d’affaires qui ont été élucidées, parce qu’ils mettent beaucoup de moyens dans l’enquête et il y a des professionnels qui ne s’occupent que de ça et qui mobilisent les forces de l’ordre spécialement les élucider. Donc forcément les choses avancent beaucoup plus vite », poursuit Alain Boulay. Inspiré de modèles existants aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce pôle bénéfi cie des avancées scientifi ques, notamment en matière d’ADN et d’intelligence artifi cielle qui ouvrent de nouvelles perspectives pour identifi er des suspects ou corroborer des pistes.
Mais qu’est-ce qu’un cold case exactement ? Jacques Dallest, magistrat du pôle cold case, le définit comme un crime non élucidé, généralement un meurtre ou un viol, dont l’enquête n’a pas abouti à l’identification d’un auteur. « Un crime, tout le monde peut le commettre », rappelle- t-il. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas forcément d’actes perpétrés par des individus aux profils atypiques : « Ce n’est pas réservé à des gens bizarres ou à des fous, un crime ça peut être fait par n’importe qui. En général plus les hommes que les femmes, mais ça peut aussi être fait par des femmes ». Le magistrat distingue plusieurs types d’aff aires non élucidées. Certaines restent ouvertes malgré l’absence de suspect identifié, d’autres, faute d’éléments nouveaux, sont clôturées et archivées, bien qu’elles puissent être rouvertes si des preuves émergent avant la prescription. « La loi française dit qu’au bout de 20 ans, on ne peut plus rien faire, même si l’auteur se manifeste », précise- t-il. Il évoque également les disparitions inquiétantes, qui peuvent résulter d’accidents, de suicides, de morts naturelles ou encore de fugues volontaires. Mais lorsqu’elles s’inscrivent dans un cadre criminel, elles relèvent également du travail du pôle cold case. Toute la difficulté de ces aff aires repose sur le temps qui passe, effaçant progressivement les traces, dispersant les témoins et laissant parfois le crime impuni. « Plus le temps passe, plus ça joue en la faveur du meurtrier », reconnaît Jacques Dallest. C’est précisément pour cette raison que le pôle de Nanterre représente une avancée : il off re une structure dédiée à ces enquêtes de longue haleine et leur redonne une visibilité, refusant de laisser l’oubli triompher. « Même si l’histoire date d’il y a longtemps, on ne baisse pas les bras, parce qu’il ne faut pas oublier que derrière chaque meurtre ou chaque viol, il y a des familles », termine Jacques Dallest.
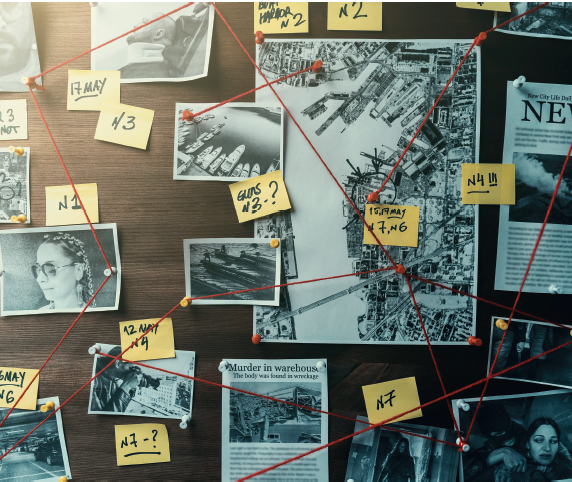
Des familles en attente de justice
Derrière chaque cold case, il y a des familles qui attendent depuis des années, parfois des décennies, une réponse à leur souff rance. L’absence de vérité et de justice maintient ces proches dans un deuil inachevé. Alain Boulay, qui a perdu sa fi lle à la suite d’une agression, a décidé de créer l’association Aide Aux Parents d’Enfants Victimes (APEV) en 1982. Il aide de nombreuses familles et souligne l’importance de leur accompagnement : « Lorsqu’une famille nous contacte, c’est souvent par téléphone. Ensuite, on prend rendez-vous et on essaye d’organiser une rencontre physique le plus rapidement possible. Puis, on entame les démarches pour faire avancer l’enquête au plus vite ». Mais ces démarches sont souvent longues. « On est à peu près à 250 familles accompagnées mais pour les enquêtes qui ont réellement abouti à l’identifi cation d’un coupable, il doit y en avoir une douzaine », reconnaît Alain Boulay. Malgré tout, chaque réouverture d’un dossier représente une lueur d’espoir, « Il y a toujours des enquêtes en cours et on espère qu’un jour elles seront élucidées. En tout cas, nous allons tout faire pour. » L’attente ne s’arrête pas toujours à l’identifi cation d’un suspect. Le procès, souvent programmé des années après l’arrestation, prolonge cette période d’incertitude. « Le but final, c’est d’aller jusqu’au procès, et souvent cela prend deux ou trois ans après avoir trouvé le criminel », explique-il. Pendant ce temps, l’association continue d’accompagner les familles qui doivent aff ronter une épreuve judiciaire éprouvante. Mais une fois le procès terminé, une nouvelle étape commence : celle du deuil. Certaines familles choisissent alors de s’éloigner de l’association pour tenter de se reconstruire, tandis que d’autres trouvent du réconfort dans l’entraide et le partage d’expérience. « Très régulièrement, les familles deviennent à leur tour bénévole pour pouvoir aider d’autres familles», raconte Alain Boulay. Pour cela, des réunions annuelles permettent aux proches de victimes de se retrouver, d’échanger et de soutenir ceux qui n’ont pas encore obtenu justice. « Ces groupes de paroles sont très importants et très réconfortants, autant pour les familles dont le procès est terminé depuis des années que pour celles qui attendent encore des réponses ». Si l’association ne dispose pas de psychologues en interne, elle peut compter sur un réseau de professionnels prêts à intervenir en cas de besoin. « Nous connaissons beaucoup de monde, donc nous pouvons faire appel à des avocats, des magistrats ou encore des psychologues pour aider les familles en détresse ». Une aide précieuse qui leur permet de ne pas se sentir seules face à l’attente et à l’incertitude. Avec la médiatisation des aff aires non élucidées, de nombreuses associations ont vu le jour, comme l’association des « Vétérans ». Certains amateurs se prennent au jeu et se découvrent une véritable vocation pour l’enquête. Parmi eux, d’anciens policiers, mais aussi des amateurs curieux, désireux de décoder des énigmes criminelles sur leur temps libre. Si peu d’enquêtes aboutissent grâce à eux, leur contribution reste précieuse. Cette ferveur peut néanmoins avoir ses dérives. Sur les réseaux sociaux, des innocents sont parfois accusés à tort et ont été victimes de fausses accusations et de harcèlement. Si ces détectives amateurs peuvent relancer certaines affaires, ils doivent rester conscients des limites de leur engagement.

L’apport de nouvelles technologies
Les avancées technologiques ont profondément transformé le travail des enquêteurs et magistrats, leur permettant de revisiter des aff aires classées avec un regard neuf. Parmi ces innovations, l’ADN occupe une place centrale. « Maintenant avec l’ADN, on peut réussir à faire un portrait génétique de l’agresseur, chose à laquelle nous n’avions pas accès dans les années 70. Donc on peut réussir à trouver la race, l’âge, même bientôt, la taille ou la couleur des yeux, enfi n on peut trouver énormément de renseignements sur la personne », souligne Alain Boulay. Grâce aux progrès scientifi ques, une simple trace peut devenir une piste décisive pour identifi er un suspect. « Un cheveu, une goutte de sang, un emballage de bonbons, toutes ces petites choses ça peut faire avancer une enquête tout entière », ajoute Jacques Dallest. L’évolution des techniques d’analyse ADN a radicalement changé la manière dont les cold cases sont abordées. « Il y a 20 ou 30 ans, il fallait beaucoup de matière pour obtenir un profi l, maintenant il suffi t de quelques cellules », explique Olivier Le Gall, ancien enquêteur de la gendarmerie aujourd’hui intégré au cabinet de l’avocat Didier Seban. Cette avancée permet de réexaminer des scellés datant de plusieurs décennies et d’en extraire de nouvelles informations. « Il faudrait redemander des analyses sur un ancien dossier parce qu’avec les nouvelles technologies, le résultat pourrait être intéressant », ajoute Olivier Le Gall, en soulignant l’importance de la réévaluation des preuves matérielles. Outre l’ADN, les nouvelles méthodes d’investigation assistées par intelligence artifi cielle (IA) offrent des perspectives inédites. Les algorithmes permettent de recouper des masses de données en un temps record, facilitant l’identification de connexions autrefois invisibles aux enquêteurs. La reconnaissance faciale, l’analyse comportementale ou encore la prédiction criminelle sont autant d’outils qui enrichissent les enquêtes. « Par exemple, en Chine, il y a la reconnaissance faciale. Dans une foule, ils sont capables de voir qui est un repris de justice. Nous en France on ne le fait pas mais on voit bien que dans le monde, il y a quand même de plus en plus d’avancées technologiques », observe Jacques Dallest. « J’essaye d’apporter un oeil neuf dans le cabinet de monsieur Seban, avec de nouveaux angles de vue », Olivier Le Gall s’appuie sur ces innovations pour analyser des dossiers et repérer d’éventuelles failles dans les enquêtes passées. Mais ces avancées soulèvent également des questions éthiques. Jusqu’où peut-on aller dans la collecte et l’exploitation des données personnelles ? « Peut-être qu’un jour, nous aurons des puces GPS dès la naissance pour éviter les disparitions », imagine Jacques Dallest, illustrant les dilemmes que pose l’évolution technologique. Si ces solutions pourraient prévenir certains crimes, elles interrogent sur le respect des libertés individuelles et la protection de la vie privée. Malgré ces interrogations, une chose est certaine : l’évolution des outils d’investigation ne cessera de progresser. « Il y aura toujours des crimes, mais il faudra trouver des évolutions pour les élucider plus facilement et rapidement », conclut Jacques Dallest.

Entre espoir et limites
Depuis son ouverture il y a deux ans, près de 400 procédures ont été examinées par ce parquet spécialisé, marquant ainsi un premier pas signifi catif vers la résolution des cold cases en France. Bien que la résolution de tous les dossiers non élucidés demeure un objectif ambitieux, les avancées technologiques actuelles off rent des perspectives encourageantes pour les enquêtes. En France, on recense actuellement entre 280 et plus de 1 000 affaires non élucidées, un nombre considérable qui souligne l’ampleur du défi . L’intégration de l’intelligence artificielle dans les enquêtes, permet de traiter des volumes massifs de données en un temps record. Ces outils technologiques, notamment l’analyse de grandes bases de données, l’exploitation de l’ADN et la mise en oeuvre d’algorithmes avancés permettent de donner un nouveau souffl e aux enquêtes anciennes. De plus, la création de structures spécialisées, comme le pôle cold case de Nanterre, témoigne d’une volonté institutionnelle de s’attaquer spécifiquement à ces dossiers complexes. Malgré, ces progrès notables, il est important de souligner que toutes les aff aires non résolues ne pourront probablement pas aboutir à une conclusion favorable. La dégradation des preuves avec le temps, la disparition de témoins et l’absence de nouveaux éléments compliquent énormément le travail des enquêteurs. Dans certains cas, il est possible que l’espoir de justice se dissipe avec les années, rendant ces aff aires particulièrement difficiles à élucider, malgré les efforts déployés. Actuellement composé de trois juges d’instruction, de trois greffiers et de deux juristes assistants, le pôle cold case de Nanterre reste néanmoins sous-dimensionné pour répondre pleinement à la complexité et à l’ampleur des aff aires non élucidées. Bien que ces équipes soient spécialisées et motivées, le manque de moyens alloués à cette structure a suscité des critiques, notamment concernant le nombre de dossiers à traiter et les ressources humaines insuffisantes pour garantir une efficacité optimale. Les informations disponibles concernant les ressources humaines du pôle montrent un personnel restreint, tandis que les données concernant le budget alloué à ces aff aires n’ont pas été publiquement divulguées. Cependant, pour pallier cette situation, le recrutement d’un quatrième magistrat est prévu pour 2025; une initiative qui vise à alléger la charge de travail des équipes en place.
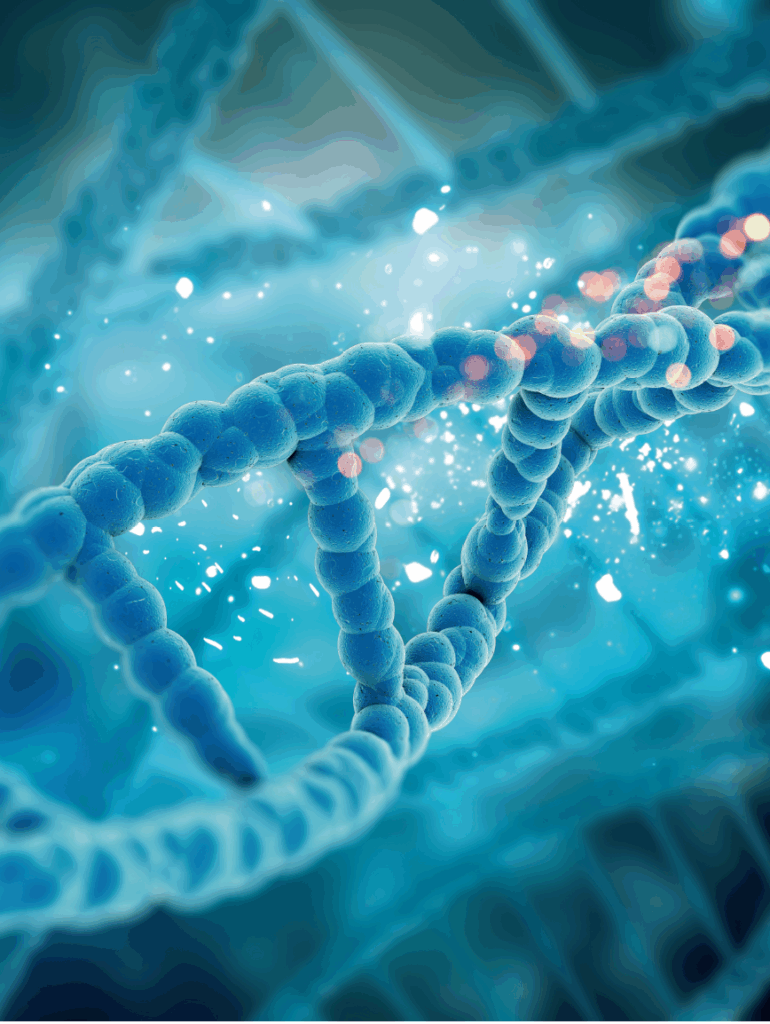
Cette mesure, bien qu’attendue, souligne néanmoins que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer les moyens de ce pôle et offrir aux familles la justice qu’elles méritent. Bien qu’en France, la création du pôle cold case à Nanterre marque une avancée significative, les États-Unis restent bien plus avancés en matière de traitement des affaires non élucidées. Le pays dispose de nombreux pôles spécialisés, comme ceux à Los Angeles ou à New York, qui depuis plusieurs années se sont dotés de ressources considérables pour traiter ces dossiers, notamment en intégrant des technologies de pointe et des équipes dédiées. Par exemple, la base de données CODIS (Combined DNA Index System) permet aux enquêteurs américains de croiser des milliers d’échantillons dans le pays, facilitant la résolution de nombreux cold cases. Cette infrastructure est un modèle d’efficacité comparé à la situation en France, où les moyens restent encore insuffisants malgré la volonté de progrès. Ce décalage se retrouve également dans la culture populaire, où des auteurs comme Michael Connelly, à travers son personnage de l’inspecteur « Harry Bosch », popularise l’idée de résoudre des cold cases avec détermination et technologie. Dans ses romans, Connelly expose un univers où l’investigation scientifique et la persévérance des enquêteurs permettent de faire éclater la vérité, une approche dont la France pourrait s’inspirer davantage. Ainsi, bien que des progrès aient été réalisés, le modèle américain, plus institutionnalisé et mieux financé, pourrait offrir des leçons précieuses pour optimiser la gestion des cold cases en France.