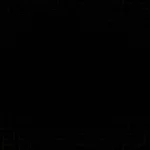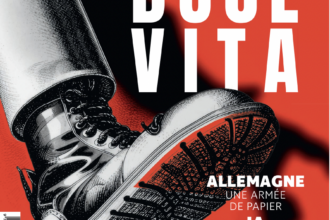Certaines cultures survivent durant plusieurs millénaires, c’est le cas de la culture berbère, appartenant à un peuple réparti au sein de l’Afrique du Nord. Quitte à être occultée par les pouvoirs centraux, cette culture perdure et résiste contre l’assimilation et l’oubli. C’est au terme d’un voyage entre l’Algérie, le Maroc, le Mali ou encore Paris que se retrace l’histoire du peuple berbère.
amedi 09 Novembre, à Tizi- Ouzou en Algérie, avait lieu un match de football pas comme les autres. La JS Kabylie recevait l’USM Alger, un score vierge de 0-0 au nal, mais un match en ammé qui oppose deux clubs aux antipodes l’un de l’autre. D’un côté, on retrouve le club de la capitale d’Etat, de l’autre un club qui représente toute une région à majorité berbère, occultée par le pouvoir central. Les 50 000 places du Stade Hocine Aït-Ahmed ont été une nouvelle fois remplies, symbole de la ferveur qui accompagne ce club historique, une histoire qui dépasse le simple cadre du football et qui est rattachée à toute une région, à tout un peuple, à toute une culture qui a su traverser les années et à chaque fois se relever depuis quasiment trois millénaires.
Prospérité, domination, déclin : une riche histoire
L’Afrique du Nord est un vaste ensemble multiculturel et historique, au sein duquel se trouvent les Berbères, ou plutôt les Amazighs, terme préféré par les principaux concernés. En e et, le mot «berbère» renvoie à l’époque coloniale et surtout à l’étymologie dégradante de “barbare”. De l’Oasis de Siwa (Egypte) à Agadir (Maroc), de Bejaïa (Algérie) à Tombouctou (Mali), le peuple amazigh est réparti dans toute la région, en plusieurs ethnies avec chacune ses propres coutumes, ses langues mais unies derrière un héritage commun. Cet héritage millénaire trouve ses racines très tôt dans l’Antiquité. La première mention d’un peuple berbère date de l’arrivée des Phéniciens en Afrique du Nord aux alentours de 900 avant J.C, ces deux groupes ont parfaitement vécus en harmonie par la suite. C’est au cours de cette période que la cité phénicienne de Carthage sort de terre en actuelle Tunisie, la civilisation carthaginoise se développera et mettra en place l’alphabet Ti nagh, un ensemble de signes et d’épitaphes que les Berbères utiliseront progressivement comme alphabet pour retranscrire leur langue, jusqu’alors orale et divisée en de nombreux dialectes. Les di érents peuples berbères vont fonder et faire prospérer de nombreux royaumes, cohabitant successivement avec les Phéniciens, les Romains, les Vandales (ndlr : peuple barbare germanique) et les Byzantins pendant plusieurs siècles. En 642 débute la conquête et la colonisation arabe de l’Afrique du Nord qui s’achèvera progressivement aux alentours de 710, la religion musulmane s’impose petit à petit mais les Berbères restent l’ethnie dominante dans la région face aux Arabes. Plusieurs dynasties berbères vont alors se succéder lors de l’âge d’or Islamique (750-1600), elles vont parfois s’étendre sur d’énormes territoires allant du Maghreb à la Péninsule Ibérique en passant par le Sahel avant de progressivement décliner, par la suite, face à l’arabisation progressive de la zone.
Les indépendances : l’étouffement culturel
Ferhat Bouda, photographe algérien, se souvient, lui qui a grandi en Kabylie dans les années 80, au plus fort moment de la revendication amazighe : “Je fais partie de cette génération qui a vécu le déni culturel dans ces régions. Quand on est jeune on ne se rend pas compte mais avec le temps on comprend que ce n’est pas normal, nos grands-parents ont fait la guerre pour être libres un jour et ils ne sont toujours pas libres dans leur pays” avant d’enchaîner “Tu te rends compte que tu vis dans un pays où tu as les mêmes devoirs que tout le monde mais pas les mêmes droits, il y a un droit principal qui est ta langue mais tu ne peux même pas l’étudier à l’école”. Sa génération a vu naître le mouvement culturel berbère qui a explosé au cours des années 80 dans un contexte d’étou ement par le pouvoir central arabe. Pour comprendre comment on en est arrivé à un tel oubli d’une culture millénaire, il faut revenir aux indépendances. Les années 1954 à 1962 marquent le drame de la Guerre d’Algérie, une période sanglante durant laquelle plus d’un million d’Algériens perdent la vie. Lors de ce con it, les Kabyles prennent encore une fois une place importante. La région montagneuse sert de refuge à de nombreux maquisards et de nombreux hommes des montagnes y perdent la vie combattant, aux côtés des rebelles. C’est après l’indépendance que tout va basculer. Dès 1963, la Kabylie se soulève face à un pouvoir central jugé trop autoritaire et refusant une Algérie à parti unique proposée par le FLN (ndlr : le Front de Libération National, principal parti vainqueur de la guerre). Le FLN a écarté tous ses opposants y compris les socialistes de Kabylie, ce dernier ne tarde pas à considérer la région comme séparatiste et dans un souci d’homogénéité nationale, n’hésite pas à stigmatiser la culture berbère en imposant l’arabe comme la seule langue nationale tout en occultant la mémoire des peuples berbères. Lors de leurs indépendances successives en 1956 (Maroc, Tunisie) et en 1960 (Mauritanie, Mali, Niger), les pays d’Afrique du Nord adoptent eux-aussi une idée d’Etat-Nation uni derrière une langue, une histoire et une culture communes, c’est dans ce cadre que les populations berbères se retrouvent stigmatisées et leur identité est oubliée.
“Printemps Berbère” : une prise de conscience collective »
«Ce qui s’est passé en Algérie, c’est comme en Amérique où ils ont arraché les enfants indiens pour les mettre dans des écoles américaines et les transformer en Américains” continue Ferhat, témoignant ainsi de la situation qui a donné lieu au “printemps berbère” dans les années 1980. Les étudiants prennent conscience qu’on leur a enlevé leur identité kabyle et décident de se mobiliser en masse pour faire reconnaître leur culture, pour qu’on leur rende leur identité. Une révolution silencieuse s’opère à travers une convergence des luttes entre les plus jeunes qui souhaitent revendiquer cette identité qu’ils n’ont pas connu et les plus vieux qui se sont battu pour l’indépendance d’un pays qui ne les considère même pas comme faisant partie de leur histoire. A l’orée du nouveau millénaire tout s’en amme, “En 2001, pendant une manifestation, la police à embarqué un lycéen et ils l’ont tué dans la gendarmerie, le Ministre de l’Intérieur il ne s’est pas excusé, il a dit que c’était un voyou” nous explique Ferhat. «Le 20 Avril, les gens se sont rassemblés, la police a tiré avec des balles réelles, il y a eu 127 morts. Depuis, chaque 20 Avril, on continue de manifester dans la rue en Kabylie contre la dictature” poursuit-il. Après un demi-siècle de lutte, l’Algérie reconnaît en 2016 la langue berbère comme langue officielle et, en 2018, proclame Yennayer (ndlr : le nouvel an berbère, célebré entre le 12 et le 14 Janvier selon les régions) jour férié. Au Maroc, on crée un institut de la culture amazighe en 2001 et on o cialise la langue en 2019, on rend même Yennayer férié en 2023. Partout, dans tous les pays d’Afrique du Nord on reconnaît progressivement une forme d’identité berbère mais on est encore loin du compte selon Ferhat : “Il nous faut des linguistes et tout, on a besoin de créer des académies si on veut que cette culture survive, moi je veux travailler avec ma langue chez moi, pouvoir parler ma langue si j’ai un problème avec la justice. Ils sont très forts dans leur politique, c’est juste pour calmer les masses, moi je ne leur fais pas con ance, ils continuent de te dire que l’arabe c’est la parole de Dieu mais l’Islam c’est quelque chose de spirituel. Il n’y a aucune langue au-dessus des autres, moi je n’ai aucun problème avec l’arabe mais pour moi c’est comme le français ou le chinois, c’est une langue étrangère”.
Une culture qu’il convient de faire perdurer
Dans le calendrier amazigh, nous sommes en 2974. Cette année est le symbole d’une longévité rarement observée au cours de l’Histoire, la culture berbère continue de perdurer depuis bientôt 3 millénaires. Mais, en Afrique du Nord, aujourd’hui les peuples berbères sont dans des situations bien di érentes. C’est ce que Ferhat Bouda, installé en Allemagne depuis 2005, qui avait conté son enfance plus tôt, tente de montrer à travers son objectif. Il commence par photographier sa Kabylie natale au début des années 2000, au plus fort des tensions contre le pouvoir central, avant de voyager dans tout le monde berbère. “Je me suis dit, il faut raconter cette histoire amazighe en photo, j’ai décidé de faire le tour de l’Afrique du Nord quand les révolutions ont éclaté en 2011, pour montrer cette culture qu’il faut préserver” posant les bases du voyage qu’il a e ectué entre le Maroc, l’Algérie, le Mali ou encore la Libye et l’Egypte. Il a photographié les rebelles berbères de Libye opposés au pouvoir de Kadha , ces derniers ont joué un rôle décisif dans le renversement de la dictature mais aujourd’hui ils continuent de lutter pour leur reconnaissance et l’avancée de leurs droits. Dans certaines zones d’un pays plongé dans le chaos on peut parfois apercevoir des drapeaux berbères qui remplacent le drapeau libyen. Il est également parti capturer les moments de vie des rebelles de l’Azawad (ndlr : territoire touareg au nord du Mali, en révolte depuis 1963). La zone est extrêmement dangereuse car elle mêle groupes séparatistes, djihadistes et narcotrafiquants. Aujourd’hui encore, aucun pays ne reconnaît l’Azawad et le con it qui oppose les séparatistes à l’armée malienne continue toujours. Il a exposé cette année au mois de mars au Havre et a eu l’occasion de s’exprimer par ce moyen plusieurs fois en France au cours de sa vie. Il s’agit pour lui d’une vitrine lui lui permettant de montrer et préserver à sa façon une culture qui est parfois bien trop méconnue du monde occidental. “ Ma culture n’est pas meilleure que les autres, moi je veux juste vivre comme les autres, avec ma dignité” conclut-il à la n de notre entretien. La modernisation et l’exode rural incitent les jeunes berbères à délaisser de plus en plus leur langue maternelle au pro- t de l’arabe, les sociétés très patriarcales d’Afrique du Nord étou ent la société berbère matriarcale, les livres d’histoire des pays nouvellement indépendants occultent le rôle joué par les berbères dans ce qui fait l’identité actuelle de ces pays. La volonté des plus jeunes de se réapproprier une culture qu’ils n’ont pas eu la chance d’exprimer, la volonté des plus vieux de montrer qu’ils font partie de cet ensemble qu’est l’état-nation, la volonté des expatriés de faire connaitre cette culture à l’ensemble du monde occidental pour la préserver. Ce corpus d’actions fait que la culture berbère va continuer de vivre, de se développer et, espérons-le, ne pas tomber dans les oubliettes de l’histoire. On a coutume de dire que l’histoire est écrite par les vainqueurs, le peuple amazigh sera peut-être le vainqueur de demain.