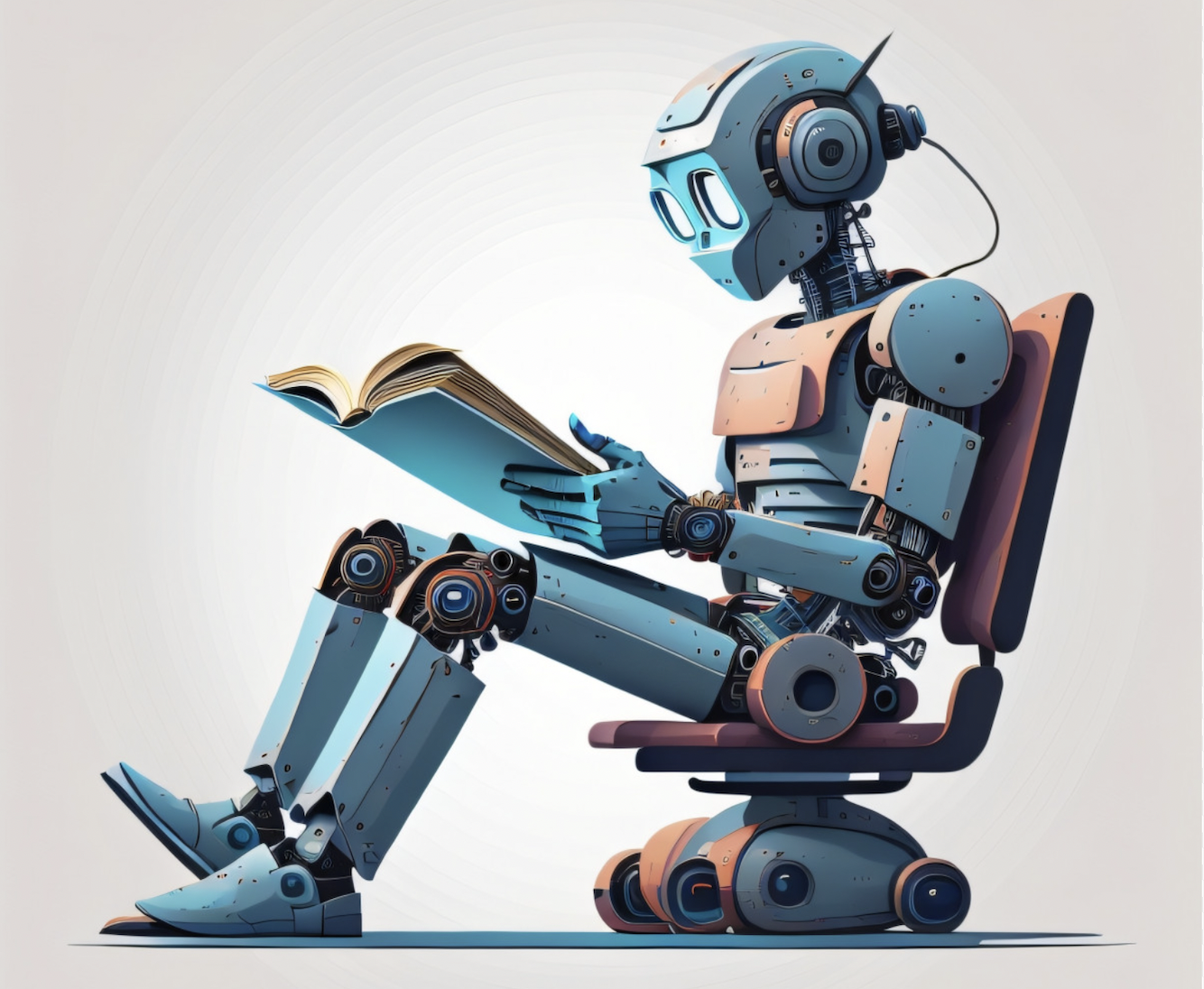En versant 1,5 milliard de dollars pour éviter un procès, la start-up américaine Anthropic a reconnu l’utilisation d’ouvrages piratés afin d’enrichir son intelligence artificielle. Un règlement record qui met en lumière un dilemme crucial : comment développer des IA sans bafouer le droit d’auteur ni fragiliser les créateurs ? Entre précédents juridiques et perspectives européennes, cela met en avant les limites de la propriété intellectuelle à l’ère numérique.
Par Sascha Beaucé-Biaggi

L’Europe face au casse-tête du droit d’auteur
De l’autre côté de l’Atlantique, l’affaire Anthropic résonne comme un avertissement. L’Union européenne s’est dotée d’un AI Act en 2024, destiné à encadrer le développement des intelligences artificielles. Ce texte impose notamment aux entreprises de révéler les données utilisées pour entraîner leurs modèles, et reconnaît le principe d’opt-out pour les ayants droit (les œuvres protégées peuvent être utilisées par défaut, sauf si les ayants droit expriment explicitement leur refus). Mais dans les faits, ce mécanisme de text and data mining (TDM) reste peu protecteur. La comparaison entre droit européen et droit français révèle un paradoxe. L’Europe a mis en place des directives à travers l’AI Act afin de chercher un équilibre entre innovation et protection. En comparaison la France reste fidèle à une tradition juridique protectrice issue du Code de la propriété intellectuelle : l’accord de l’auteur est indispensable en cas d’exploitation d’une de ses œuvres. En théorie, en France, les écrivains bénéficient d’une certaine protection juridique solide mais la réalité est bien plus nuancée car à l’échelle mondiale, l’utilisation de ces données face à l’IA échappe aux juridictions nationales et soulève la difficulté de faire prévaloir le modèle français dans un cadre européen et international plus conciliant avec les géants technologiques.

Certains juristes estiment que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), initialement conçu pour protéger les données personnelles, pourrait devenir une arme contre l’exploitation abusive des œuvres mais reste encore trop insuffisant « face à l’explosion des IA ces dernières années, les systèmes mis en place pour protéger les droits d’auteur restent encore trop insuffisante » affirme Aurore Bonovia, une avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle. En imposant le consentement et le droit à l’effacement, il renforcerait le contrôle des créateurs sur leurs données. Le problème du RGPD est qu’il « ne traite pas vraiment l’aspect propriété intellectuelle face à l’IA alors qu’un texte est en discussion depuis 2019 » continue d’expliquer cette dernière. De cette manière, il faudrait « adapter mais surtout avoir des outils techniques, facilement accessibles pour les auteurs, pour détecter une violation des droits de propriété intellectuelle » selon Aurore Bonovia.
Les créateurs français en première ligne
En France, les sociétés d’auteurs comme la SACD, la SGDL ou l’ADAGP* multiplient les prises de position. Elles réclament une régulation plus stricte, voire l’instauration d’une redevance obligatoire sur l’usage des œuvres dans l’entraînement et l’enrichissement des IA, à l’image de la copie privée. Pascal Rogard, directeur de la SACD, dénonçait déjà en mars 2024 dans Le Monde que « la France a laissé tomber la défense du droit d’auteur pour faire plaisir aux champions de l’IA comme Mistral ». Une critique sévère qui illustre la « peur des auteurs sur le fait que leurs données se retrouvent dans un outil d’IA » selon Aurore Bonovia. Certains y voient une révolution comparable à l’invention de l’imprimerie. D’autres la rapprochent du piratage massif de la musique dans les années 2000, qui avait forcé l’industrie à se réinventer avec le streaming. Parmi les solutions envisagées figure l’idée d’une licence globale : les entreprises d’IA verseraient une contribution financière annuelle, redistribuée aux auteurs et éditeurs. Cet accord prévoit un paiement d’au moins 1,5 milliard de dollars, soit environ 3 000 dollars par œuvre couverte par la classe d’ayants droit. Une piste encore théorique, mais qui pourrait constituer une alternative au système de procès successifs.
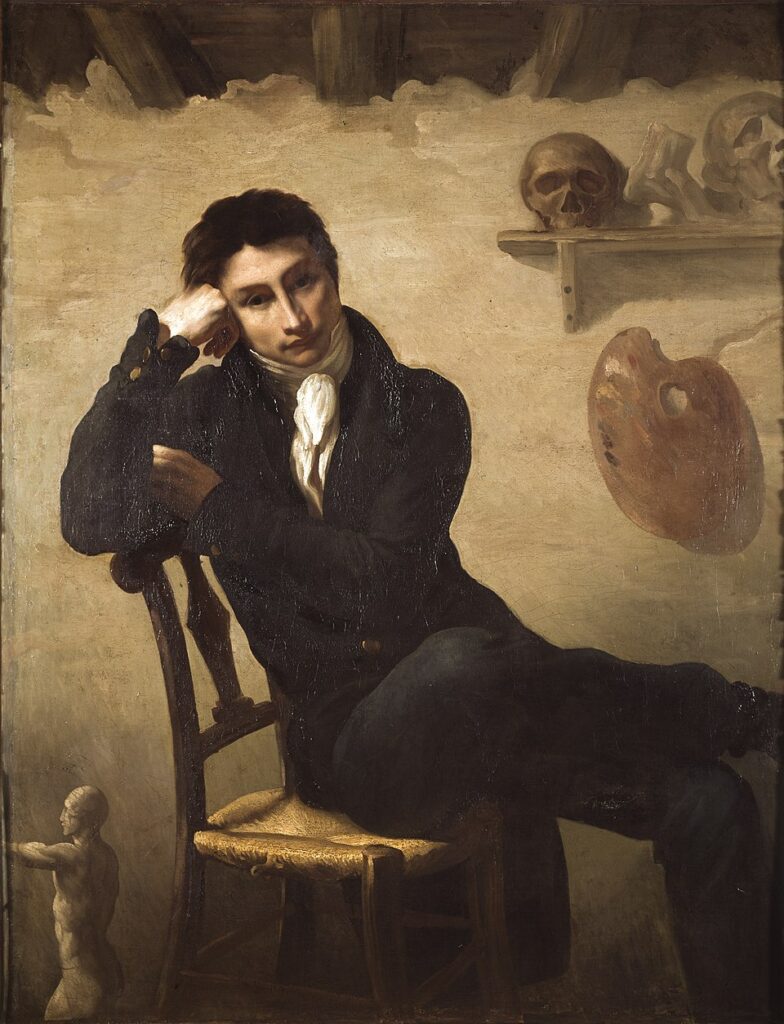
La question de la responsabilité des géants technologiques devient un enjeu central. On reproche à OpenAI, Meta, Google et Anthropic d’effectuer l’entraînement de leurs modèles sur d’immenses bases de données sans toujours indiquer clairement leur provenance. Leur manque de transparence nourrit l’idée que des millions d’œuvres soumises à des droits d’auteur pourraient avoir été prélevées sans permission. Sous l’apparence d’innovateurs, ces groupes se présentent comme des prédateurs majeurs qui établissent, à eux seuls, les règles de l’intelligence artificielle. En acceptant de payer 1,5 milliard de dollars, Anthropic a reconnu implicitement la valeur du travail des auteurs et l’illégalité de certaines de ses pratiques. Mais ce règlement ne clôt pas le débat : il ne fait que l’ouvrir. Aux États-Unis, la frontière entre fair use et piratage reste fragile. En Europe, le cadre juridique reste encore insuffisant face à l’expansion des IA. En France, les auteurs dénoncent une régulation insuffisante face aux nouvelles technologies. Toutefois, on ne doit pas oublier que ce manque d’action de la part des gouvernements est avant tout le reflet d’une décision politique de nos sociétés. Dans la hiérarchie des priorités, les intervenants de la technologie génèrent plus de profits que les artistes et créateurs culturels. Les autorités préfèrent généralement encourager la croissance et l’investissement conduits par ces grandes entreprises plutôt que d’opter pour une régulation stricte qui favoriserait la protection des droits d’auteur.
* La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Société des Gens de Lettres et l’Association pour la Diffusion des Arts Graphiques et Plastiques
Romane Legros