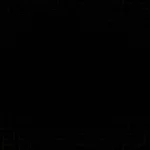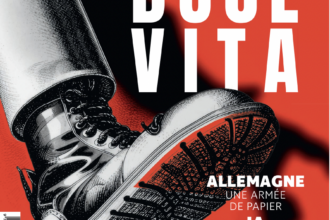Pris entre l’enclume iranienne, via ses alliés, et le marteau israélien, la population libanaise est aujourd’hui dans une situation délicate. Déjà secoués à de nombreuses reprises dans leur histoire, les chrétiens du Liban ont un rôle important à jouer, malgré un déclin considérable sur le plan démographique et politique.
« Le Liban est plus qu’un pays, c’est un message ». Ces mots sont extraits d’une lettre apostolique écrite par le pape Jean-Paul II en 1989. Ils ont pris une nouvelle résonnance depuis les frappes israéliennes sur le Liban, le 27 septembre 2024, conduisant à la mort du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Aujourd’hui, on dénombre plus de 3 000 décès parmi lesquels des soldats du groupe armée islamiste chiite, et des civils. Ancienne puissance, les chrétiens, ont vu leur pouvoir s’affaiblir sur la chaîne du Mont Liban, mais leur ancrage dans la région fait d’eux un équilibre vital pour le pays.
Terrain de guerre pour ses voisins, le Liban occupe une place géographique servant de jonction entre l’Occident et le Proche-Orient. Depuis l’attaque du Hamas perpétré contre Israël le 7 octobre 2023, la région est entrée dans une nouvelle phase. « Benyamin Netanyahou (le Premier ministre israélien), s’est lancé dans quelques choses de très aventureux qu’il va finir coûtenque coûte, constate Jonathan Sawaya, correspondant de l’AFP au Liban. Il entend vraiment remoduler la région. Donc ça passe par la destruction de l’Orient et de ses bras armés. Il faut savoir que les pays arabes voient d’un bon oeil ce qu’il se passe. » Le Hezbollah, comme le Hamas, ne sont pas apprécié par les différents régimes. Le journaliste poursuit, « Le Hezbollah est le chien de l’Iran, ils (ndlr : les guerriers du Hezbollah) sont présents en Irak, en Syrie, au Yémen. »
Si l’Arabie Saoudite a voulu s’opposer à la milice pro-iranienne, l’ampleur de celle-ci a forcé le pays du Golfe à se retirer. Aujourd’hui, elle tente d’exister à travers les Forces Libanaises, une des milices chrétiennes très engagée, mais pauvre comparée à son homologue chiite. La victoire récente de Donald Trump aux élections américaines va ouvrir de nouvelles discussions. Les attentes sont grandes pour les Libanais, qui espère que ce dernier va trouver un terrain d’entente pour calmer les tensions et la machine destructrice lancée par Netanyahou. « Qu’on l’aime ou non, c’est un homme qui assume ce qu’il dit. S’il a dit qu’il voulait cesser les conflits ici, il faut le croire » espère Jonathan Sawad.
Placé sous protectorat français en 1922, la souveraineté libanaise est officiellement reconnue par la France le 3 janvier 1944. Le Liban est alors majoritairement chrétien et la prospérité règne sur le pays. Considérée comme la « Suisse du Moyen-Orient », le développement économique est rapide et considérable, et les institutions se développent. L’État grandit, soutenu par l’occident, et garde une certaine neutralité vis-à-vis des nombreux conflits qui l’entourent. Les années sont dorées pour le Liban et les différentes religions coexistent.
Un président chrétien maronite
Un pacte national libanais est mis en place en 1943. Celui-ci établit une égalité entre les communautés religieuses sur le plan politique et culturel, c’est le début du confessionnalisme. Pour établir le gouvernement, le Liban se base sur le dernier recensement des religions dans le pays, datant de 1932.
Les chrétiens représentent 51,1 % de la population, dont 28,7 % de maronites et les musulmans 48,8 %, dont 22,4 % de sunnites, 19,6 % de chiites, et 6,8 % de Druzes. C’est ainsi que le rôle de président de la République libanaise est confié à un chrétien maronite, Béchara El-Khoury. Celui de Premier ministre à un sunnite, et celui de président de la Chambre des députés à un chiite.
Si ce gouvernement ne voit aucune contestation les premières années, l’indépendance d’Israël en 1948 remet en cause sa structure. La création de l’État hébreu entraîne la fuite de 800 000 Palestiniens, dont 100 000 se rendent au Liban. Le pays du Cèdre est, à l’époque, composé d’un million d’habitants. La venue de musulmans sunnites change donc drastiquement la démographie du pays. Les chrétiens sont de plus en plus minoritaires.
Les réfugiés installés dans la région vont pérenniser leur position et cela va créer des tensions communautaires dans le pays. En 1967, la Guerre des Six Jours (5 au 10 juin 1967) va opposer Israël aux pays arabes voisins : la Syrie, la Jordanie, l’Irak et l’Égypte. Par ses Palestiniens enracinés dans le sud du pays, le Liban se retrouve malgré lui engagé dans le conflit.
La guerre civile, fracture pour les chrétiens
À la fin de cette courte guerre, les tensions confessionnelles grimpent et une escalade des violences est crainte. Le 13 avril 1975, dans le quartier de Ain El Remmaneh, à Beyrouth, des combattants de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), organisation politique et militaire, tuent quatre chrétiens à la sortie d’une église. La riposte ne tarde pas. Quatre heures plus tard, des miliciens du parti Kataeb, anciennement appelé Phalanges Libanaises, attaquent un bus transportant des Palestiniens. Ils assassinent les vingt sept passagers. Cela marque le début de la guerre civile au Liban. L’invasion de la Syrie, puis d’Israël, donne au con it une tournure régionale dans le Proche-Orient. Mais cela ne s’arrête pas seulement à une guerre entre musulmans et chrétiens. Rapidement, les clivages entre les communautés s’accentuent. Des attaques inter-chrétiennes et interchiites ont lieu. Tanya Awad, libanaise de 53 ans, membre d’Adyan, organisation travaillant sur une approche positive de la diversité et sur l’interaction entre les religions et la sphère publique, explique que « les chrétiens sont divisés entre ceux du nord, qui soutiennent l’identité arabo-musulmane de la région, qui ont de l’affinité pour la Syrie et le Hezbollah et ceux de la région de Beyrouth, de Kesrouan. » Elle rajoute que « politiquement parlant, il n’y a jamais eu une seule entité chrétienne au Liban. Il y a plusieurs partis pris à travers l’histoire. »
Le général Michel Aoun, alors encore lieutenant-colonel, se fait repérer et gravit rapidement les échelons. Il gagne la confiance du président de la République libanaise, Amine Gemayel (1982-1988), en défendant le palais présidentiel de Baabda de l’invasion d’Israël. Au cours de l’année 1982, il est nommé commandant des Forces armées libanaises avant d’être désigné président du Conseil intérimaire en 1988. Dans ses rangs, le Parti national-libéral, laïc, le Parti des Druzes libres, et la milice chrétienne des Forces libanaises. Ces derniers se rebellent en février 1989, quand l’armée libanaise tente de leur reprendre le contrôle des ports. Avec ce conflit, la fracture entre les chrétiens divise les Libanais. Une fracture qui perdurera dans les relations entre
les chrétiens du Liban. Ce con it durera quinze ans, fera 120 000 morts et plus de 800 000 déplacés, dont 80 % sont chrétiens. Eliejo Kamel, journaliste pour Ici Beyrouth, estime que « les 15 ans de guerre civile ont ruiné ce joyau qu’était le Liban. »
Accord de Taëf, déclin politique chrétien
réconciliation nationale, mais également l’installation d’un cessez-le-feu dans le pays. Ce sont les e orts politiques d’un comité composé du roi Hassan II du Maroc, du roi Fahd d’Arabie Saoudite, du président Chadli d’Algérie et du soutien de la diplomatie américaine, qui font que la guerre civile se termine o ciellement. Par cet accord, le pouvoir est réorganisé entre les confessions. Les prérogatives du président chrétien maronite sont réduites, au détriment du Premier ministre sunnite. Ce dernier représente les musulmans toujours plus nombreux sur le territoire. Si en échange, les chrétiens demandent le retrait de l’armée syrienne, celle-ci mettra plusieurs années à quitter le territoire – il faut attendre mars 2005 pour un retrait total. L’accord de Taëf est vivement contesté. D’abord par le chef de la communauté chiite, Nabih Berri, et celui de la communauté Druze, Walid Joumblatt, pour qui celui-ci pro te principalement aux sunnites. Puis au général Michel Aoun, qui refuse l’accord. Selon lui, la présence de l’armée syrienne sur le territoire est entérinée par ce traité. Le général est évincé en octobre 1990 à la suite d’une attaque de l’armée syrienne et de dissidents de l’armée libanaise. En 1991, un traité de fraternité, de coopération et de coordination est signé entre le Liban et la Syrie. Nombreux sont ceux qui estiment que cet accord est l’o cialisation de l’annexion du Liban par son voisin.
Les années 2000, marginalisation des chrétiens
À partir de 1991, les sunnites connaissent une période fastueuse. Pour les chrétiens, la situation est plus délicate comme le rappelle Luc Balbont, écrivain et reporter spécialiste du Liban, « Ils [les chrétiens] sont exclus des discussions politiques. » Nombreux dirigeants sont forcés à l’exil, emprisonnés et assassinés. Anti-syriens, l’in uence politique des chrétiens maronites va poursuivre son e ondrement lorsqu’elle voit le régime de Bachar al-Assad désigner des personnalités politiques selon ses intérêts. C’est ainsi qu’en 1992, Ra q Hariri est nommé Premier ministre et engage une reconstruction du pays. Le « protégé » de l’Arabie Saoudite veut reconstruire le Liban et souhaite redonner aux chrétiens une place dans l’échiquier politique en incluant certains maronites dans le gouvernement. La Syrie s’y oppose. Jusqu’en 2005, le Liban connaît une certaine stabilité. Malgré des séquelles de la guerre civile, encore visible, la reconstruction se fait. Nonobstant, Tanya Awad dénonce « une reconstruction matérielle, mais pas de la population. » Le 14 février 2005, Ra q Hariri est victime d’un attentat au camion piégé. Il meurt, ainsi que l’ancien Premier ministre et député Bassel Fleyhane. La Syrie est soupçonnée d’en être le commanditaire, et le nouveau Premier ministre libanais, Omar Karamé, accusé d’une certaine responsabilité. La révolution du Cèdre commence. Une marche est programmée le 14 mars. Un million de personnes se réunissent sur le goudron chaud de la place des Martyres, en plein coeur de Beyrouth, et réclament la vérité sur la mort de Ra q Hariri. En opposition, le 8 mars, ce sont 800 000 contre-manifestants qui s’emparent des rues de la capitale pour soutenir le nouveau gouvernement mis en place, celui d’Omar Kaé. En naissent deux alliances, l’Alliance du 14-Mars, qui s’oppose à l’in uence syrienne au Liban, et l’Alliance du 8-Mars, qui s’oppose à la coalition anti-syrienne. Une nouvelle fois, les chrétiens se divisent. Tanya Awad décrit « une nouvelle grande coupure. Une partie des chrétiens, avec le général Aoun, décide de tendre la main au Hezbollah. Une autre partie choisit le côté sunnite, et tout chiites qui n’est pas pro Hezbollah, en disant non, on veut un pays, un gouvernement, une armée libanaise. Il faut arrêter avec le Hezbollah et sa milice. » On a donc d’un côté la famille Gemayel, une des plus importantes au Liban, le parti des Kataeb et les Forces Libanaises, qui s’allient, avec une majorité des maronites, aux sunnites. De l’autre, le général Aoun, de retour au pays après un exil de quinze années en France, représente les maronites soutenant le tandem chiite Hezbollah-Amal. Cette période, après les heures de gloire du christianisme et du sunnisme, offre aux deux frères chiites leur âge d’or.
L’économie, talon d’Achille du Liban
Le Liban est un pays reconnu pour son ouverture, ses grands intellectuels (Amin Maalouf, Elias Khoury), ses chanteurs (Fairuz, Mika, Ibrahim Maalouf), ses écrivains (Wajdi Mouawad, Charif Majdalani), ses quotidiens (L’Orient-le Jour, Ici Beyrouth). Mais le Liban est également connu pour son économie particulièrement instable. Selon un bilan de la Banque mondiale publié en mai 2024, un Libanais sur trois vit sous le seuil de la pauvreté. Si son système scolaire et ses institutions en font un pays majeur sur le plan international, ses problèmes nanciers, récurrents depuis son indépendance en 1943, ne sont pas moteurs pour la jeunesse. « On adore tous la bre de vie libanaise, ça nous manque à tous, on ne la retrouve nulle part ailleurs. Malheureusement, les chrétiens et les musulmans ne peuvent plus supporter la crise économique » déplore Tanya Awad. Malgré tout, elle sait qu’avec une stabilité économique, il n’y aura pas de guerre, « c’est le seul pays de la région qui n’a jamais connu de guerre de religion non plus. » Outre l’exil de la population, l’instabilité économique a également touché l’histoire du pays, notamment la création des milices. Celles chrétiennes ont trouvé un nancement auprès de la France et des Etats-Unis. Pour les chiites, longtemps délaissés par les populations musulmanes, ils ont obtenu un renfort de poids avec l’Iran. Le Hezbollah s’est retrouvé nancé par son voisin, implantant son statut en tant que milice indépendante de son gouvernement. C’est ce support qui a vu sa popularité grimper rapporte Tanya Awad, « les pro-Hezbollah vont dire que le gouvernement nous a laissés, on n’a pas d’école, pas d’hôpitaux. Donc si le Hezbollah paye, on ne demande pas mieux.
La mort de Nasrallah, réelle opportunité ?
compagnons martyrs ». À travers un communiqué, le Hezbollah a annoncé le samedi 28 septembre 2024 la mort de son leader. Tué lors d’un raid israélien, l’homme politique libanais, âgé de 64 ans, laisse derrière lui 32 années de service pour la milice chiite. Tanya Awad, malgré son opposition au mouvement terroriste, se rappelle « son leadership. Lorsqu’il allait parler, tout le monde était devant la télé, Libanais comme Israélien. » Mais toujours selon la membre d’Adyan, « ce leadership est facilement remplaçable, car il y a un dogme religieux. C’est un parti qu’on a laissé faire, laissé grandir depuis 1982. Maintenant, ils ont un peuple derrière eux. C’est une grande partie du peuple libanais. Ils ont l’Iran derrière eux, plusieurs pays aussi. Tuer un leader ou plus ne su ra pas à changer un dogme. Le Hezbollah, ça signi e le Parti de Dieu, donc ils mettent Dieu sur la table de la politique et de la guerre. » L’importance du Hezbollah, et de l’Iran dans les discussions politiques ne devrait pas ancher. Le président de la Chambre des députés, de confession chiite, occupe une place toujours aussi importante sur les décisions. « Les chrétiens ont perdu beaucoup de pouvoir, explique Tanya Awad. Avant, on parlait de maronicité politique (ndlr : un pouvoir principalement entre les mains du président maronite), mais il y a eu beaucoup de faute envers les musulmans. Maintenant, ce sont les chiites qui ont le pouvoir, sans que ce soit dans la Constitution. On ne peut pas élire un président chrétien sans que les chiites, mais aussi les sunnites ne soient d’accord sur son nom. »
Pour les chrétiens, « le problème est que leurs partis sont toujours divisés et ne s’entendent pas » s’attriste Eliejo Kamel. Tanya Awad, elle, ne voit qu’une façon de les unir. « Ayant vécu toute ma vie dans cet ancrage et cette division, seules les grandes causes qui vont mettre en péril la présence chrétienne pourraient marcher. Mais cette peur n’a pas atteint son apogée. » La jeunesse libanaise, elle, s’est apolitisée dans son engagement. La crainte de retomber dans une guerre civile la pousse à dialoguer, et l’oppose à la création et la survie des milices. Le journaliste d’Ici Beyrouth pense « Qu’il est temps de sortir du cercle vicieux des âges d’or et des leaders. Il faut aller vers l’édi cation d’un véritable État uni cateur et libéral. Le jour où il y aura un citoyen libanais dans un véritable État libanais, tout sera réglé. »
Les chrétiens et la jeunesse, une barque à tenir
barque à tenir Si un État uni cateur et libéral ressemble davantage à une douce utopie aujourd’hui, la jeunesse a un rôle important à jouer. Catherine Baumont, conseillère à la Direction Générale et rédactrice en chef de l’OEuvre d’Orient, regrette tout de même que « les jeunes qu’on forme, comme dans l’université Saint-Joseph, à Beyrouth, font de supers études mais partent par la suite. C’est ça la di culté. Il y a peu des jeunes qui reviennent. » C’est, au contraire, le cas de la lle de Luc Balbont. L’écrivain se réjouit que sa lle soit revenue dans son pays natal. « Elle est médecin, son mari aussi. Tous les deux avaient à coeur de revenir ici par solidarité et par amour pour le pays. » Tanya Awad raconte que son ls, à leur départ du Liban, assurait ne plus vouloir revenir au pays. Avec le contexte actuel, il veut désormais retrouver ses terres. Le travail de son organisation pousse cette jeunesse à se reconstruire et à avancer ensemble. « La jeunesse c’est l’espoir ! » Cette jeunesse doit permettre de retrouver un équilibre que les chrétiens assurent également. Monseigneur Nasrallah Sfeir, patriarche maronite défunt, disait au lendemain de la guerre civile en 1990, « On annonce régulièrement la mort des chrétiens d’Orient, mais vous pouvez constater qu’aujourd’hui nous sommes toujours là avec nos églises, nos prêtres et nos écoles. » La richesse des chrétiens du Liban inspire les autres religions par leur accueil et leur ouverture. Aujourd’hui, plus que jamais, ce rôle est important. Si le Liban n’a que peu connu la stabilité dans son pays, les tensions actuelles et la fragilisation du Hezbollah pourrait redistribuer les cartes. La jeunesse a une importance primordiale dans ce futur. Pour les chrétiens, leur place est au-delà d’un simple ancrage. Ils sont l’équilibre d’un pays dont les arts et la culture cachent les con its. « On a tous besoin les uns des autres dans ce pays » sou ait Eliejo Kamel. Cependant, cette redistribution des cartes pourrait ouvrir le champ à d’autres tensions. Les déplacements des milliers d’habitants dans d’autres régions depuis le 23 septembre 2024 montrent que certaines d’entre elles sont plus hostiles à l’accueil. Après chaque crise, le Liban a toujours su se reconstruire, jusqu’à maintenant