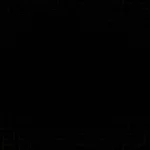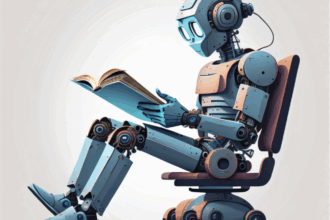En 2024, plus d’un tiers des jeunes interrogés déclare sauter souvent un repas par manque d’argent. Aujourd’hui, la précarité étudiante s’aggrave : avec des coûts du logement importants, une difficulté à trouver des travails étudiants et des aides insuffisantes. Le gouvernement considère pourtant que la précarité étudiante est une priorité et l’une des causes les plus aidées en France. ROMANE LEGROS
Bourse, repas à 1 euro, logement Crous, toutes ces mesures prises par l’État ont pour but d’aider les étudiants dans le besoin. Le 2 décembre, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, a annoncé qu’une nouvelle aide pour les étudiants ne bénéficiant pas de restauration collective à tarif modéré à proximité serait mise en place en février 2025. Il s’agira d’une carte prépayée d’un montant de 40 euros par mois pour les boursiers et 20 euros pour les non-boursiers. Selon l’enquête réalisé sur le coût de la vie étudiante en 2023 par l’UNEF (Union nationale des étudiants de France), la précarité étudiante continue de s’ancrer durablement.
Cette carte prépayée concerne 100 000 étudiants dans les zones où l’offre de restauration se situe à plus de vingt minutes à pied ou en transport en commun de leur logement. Les étudiants, qui se trouvent dans des « zones blanches » ne bénéficient pas de restaurant universitaire à tarif modéré. Ils avaient jusqu’ici moins d’aides que les autres, puisqu’ils ne pouvaient pas profiter des repas à 1 euro.
Le baromètre réalisé par l’association Cop1 révèle que par manque d’argent, 36% des étudiants sautent régulièrement un repas. Ainsi, ce sont plus de 20% des étudiants qui ont recours à une aide alimentaire. Cette nouvelle mesure de carte prépayée « a le mérite d’exister mais elle n’est pas suffisante, quand on sait que plus d’un tiers des étudiants vivent avec moins de 50 euros de reste à vivre (une fois le loyer et les charges payés) ».

A l’occasion de leur première inauguration de cantine solidaire à Paris, l’association Cop1 constate que cette mesure est « utopiste ». Le modèle qu’ils utilisent est l’aide par et pour les étudiants. Ces derniers donnent de leur temps bénévolement pour faire fonctionner l’association. Les étudiants se voient contraints d’être à l’initiative de collectifs pour s’entraider. Ces regroupements, souvent nés d’une solidarité spontanée, deviennent des espaces essentiels pour partager des informations, échanger des conseils et trouver des solutions concrètes aux difficultés qu’ils rencontrent.
Un système de bourse davantage inégal
D’autant plus que le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% en 2024, cela représente une charge de 49,56 euros par mois. Cette dernière est due à l’inflation de l’alimentation qui évolue de 14.3% ou encore l’électricité (10.1%). Le président du syndicat UNEF d’Angers Arthur Lévêque, affirme que cette mesure n’est que superficielle, « c’est comme donner des miettes à une personne qui réclame un bout de pain ». Nombreux sont les étudiants qui bénéficient d’un restaurant Crous proche de leur logement ou université mais qui n’ont toujours pas les moyens de dépenser chaque jour,1 euro au minimum. Pour certains, cette nouvelle mesure stigmatise qu’une petite partie du véritable problème que représente la précarité étudiante. C’est une façon pour le gouvernement de témoigner de leur présence sur le sujet et de présenter des mesures qui sont, dans les faits, bien insuffisantes dans la réalité.
Selon l’UNEF, s’attaquer au financement des repas semble être superficiel et cela reflète le « mépris pour les étudiants dans la société ». La précarité et les difficultés de logement sont des thèmes récurrents à la rentrée et en fin d’année, mais ne font que rarement l’objet d’une attention approfondie au cours de l’année.

À l’initiative du ministre de l’Enseignement supérieur, cette nouvelle disposition vient modifier les conditions d’obtention de la bourse sur des critères sociaux. Une partie de cette réforme est en vigueur depuis la rentrée 2024 et dépend du revenu moyen des parents. Or, un étudiant détaché du foyer fiscal et qui n’a plus de lien avec ses parents doit tout de même justifier sa demande de bourse par le revenu de ses parents.
Ainsi, un étudiant avec des parents qui possèdent de bons revenus n’aura pas le droit de toucher la bourse, que ces parents l’aident ou non « c’est ce qui crée un déséquilibre entre les étudiants qui touchent la bourse, ceux qui ont l’aide de leurs parents et ceux qui sont vraiment seuls », affirme le président de l’UNEF.
Selon l’UNEF, un étudiant en situation financière difficile, contraint de travailler en parallèle de ses études, a 46 % de chances supplémentaires d’échouer. Cela est dû au fait qu’un étudiant sur deux manque plusieurs cours par semaine en raison de son emploi (étude menée par l’Observatoire de la vie étudiante de l’Université libre de Bruxelles date). La suppression progressive des postes de surveillants dans les collèges, essentiels au bon fonctionnement des établissements, s’explique par des contraintes budgétaires et des choix politiques visant à rationaliser les dépenses publiques. Ces surveillants jouaient un rôle crucial dans la prévention du harcèlement scolaire, en assurant une présence constante dans les espaces communs et en renforçant la vigilance au sein des établissements.
En parallèle, ces emplois offraient aux étudiants une opportunité précieuse de financer leurs études en acquérant une expérience professionnelle en milieu éducatif qui s’accommodait parfaitement avec leurs emplois du temps. Leur disparition a laissé un vide à la fois en termes de sécurité et de soutien pour les élèves, tout en réduisant les opportunités de travail pour les étudiants.
La CVEC : un « impôt obligatoire pour chaque étudiant »
Malgré les nouvelles mesures du gouvernement visant à minimiser l’impact de la CVEC, chaque rentrée, un étudiant qui souhaite s’inscrire dans l’enseignement supérieur doit s’acquitter de 103 euros pour accéder à l’université.
Selon l’UNEF : « c’est comme un impôt obligatoire pour chaque étudiant ». Mais elle est remboursée en totalité pour les étudiants boursiers. En France, une année de faculté coûte à un étudiant 103 euros mais représente 10 000 à 15 000 euros par étudiant pour l’État. Cette contributionsymbolique de 103 euros semble dérisoire vu les dépenses engagées par l’État pour garantir l’accès à une formation de qualité.
Depuis quelques années, les étudiants ont tendance à faire des prêts pour financer leurs études, « ça met une épée de Damoclès au-dessus de la tête de quelqu›un pendant 5-10 ans qui, tous les mois, va devoir payer ses échéances, alors qu›il est payé au SMIC à la sortie de ses études » constate l’UNEF. Notamment dans les écoles privées où une année vaut au minimum 7 000 euros. Dans ce cas, les étudiants sont contraints de contracter un prêt allant jusqu’à 30 000 euros. Selon l’UNEF, les prêts étudiants sont devenus plus communs aujourd’hui, touchant environ 10 % de la population étudiante totale.
Une inflation qui touche les étudiants
Agoraé, une des épiceries solidaires étudiantes, joue un rôle essentiel face à cette cause « puisqu’ils vendent les produits à -90% de leur prix retrouvé en grande surface », explique la bénévole Erna Lequeuche. À l’approche des fêtes ou des périodes de rentrée, elles organisent des collectes solidaires dans les supermarchés ou sur les campus afin de remplir leurs stocks de produits alimentaires, d’hygiène ou de première nécessité.

Ces collectes sont cruciales pour répondre à une demande en augmentation, elles témoignent de la réalité d’une précarité qui touche un nombre croissant d’étudiants. Plus qu’un simple soutien matériel, cela vise aussi à créer un réseau d’entraide et de solidarité entre étudiants, « le lundi soir, il y a les distributions alimentaires Cop1, c’est terriffiant de voir le nombre d’étudiants qui attendent devant », déclare le président de l’UNEF. Ces associations permettent de venir soulager les étudiants des effets d’une inflation de 14,3% su les produits alimentaires en 1 an.
Aujourd’hui, le baromètre annuel Cop1 et IFOP révèle que 20% des étudiants ont déjà eu recours à une aide alimentaire dans leur scolarité. Ce dernier vient une nouvelle fois confirmer ce que Cop1 constate depuis sa création : la précarité des jeunes n’est pas un phénomène ponctuel lié à des difficultés économiques temporaires, mais un problème structurel exigeant une réponse immédiate et signi cative.
La « précarité », par définition, devrait être temporaire. Cependant, face à ses répercussions profondes sur la santé mentale, la réussite académique et l’intégration sociale, comment encourager les futurs étudiants à s’engager dans des études supérieures ? Les leviers à actionner pour lutter contre la précarité étudiante Les syndicats et associations luttent au quotidien pour faire réagir le gouvernement et venir davantage en aide
aux étudiants. L’UNEF réclame de nouveaux logements Crous et un entretien plus assidu, « il y a des résidences étudiantes qui tombent à l’abandon et dans la vétusté à ce point-là, ça commence aussi à se délabrer un peu », affirme l’UNEF. La diminution puis la suppression de la CVEC est la cause la plus défendue auprès des associations qui considèrent cet impôt étudiant comme injuste et qui permettrait un véritable accès gratuit à l’université.
En comparaison, les pays scandinaves sont souvent cités en modèle pour leurs politiques de soutien aux étudiants, visant à réduire leur précarité. En Suède, en Norvège et au Danemark, l’éducation supérieure est largement subventionnée par l’État, avec des frais de scolarité souvent inexistants ou très faibles, même pour les étudiants étrangers. Ces pays offrent également des aides financières sous forme de bourses et de prêts accessibles, destinées à garantir une certaine autonomie économique aux étudiants. Par exemple, en Suède, les prêts étudiantspeuvent être partiellement convertis en bourses en fonction des résultats académiques, incitant ainsi à la réussite tout en apportant un soutien financier. En Norvège, les étudiants peuvent bénéficier d’une allocation mensuelle qui couvre une grande partie de leurs frais, sans obligation de remboursement tant qu’ils terminent leur cursus complet.
Ces systèmes visent non seulement à alléger les charges financières des étudiants, mais aussi à assurer une égalité d’accès à l’éducation, permettant à chacun, quel que soit son milieu social, de poursuivre des études supérieures sans être limité par des considérations financières. Des modèles inspirants bien loin du système d’aide français. ■